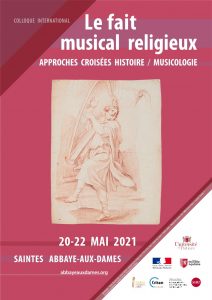• Saintes, abbaye aux Dames
11, place de l’Abbaye
• Le colloque se déroule en partie en présentiel, et en visioconférence.
Présentation
Le colloque a pour objectif de permettre aux historiens et aux musicologues d’envisager ensemble la question de la musique religieuse catholique européenne dans une perspective diachronique allant du Moyen Âge à nos jours.
S’il ne fait aucun doute que la musique relève aussi bien du domaine de l’histoire que de la musicologie proprement dite, on peut regretter que le dialogue entre les deux disciplines reste en France souvent limité à des collaborations ponctuelles. Depuis les années 1980, la révolution épistémologique qu’a connue la musicologie a conduit à aborder le phénomène musical non plus seulement du point de vue de l’œuvre mais également du point de vue des acteurs et des cadres de la création et de la performance. Elle a permis un nouveau regard sur le livre de musique et sur ses liens avec d’autres types de sources. Surtout, l’étude des pratiques musicales a favorisé le rapprochement avec les autres sciences humaines, particulièrement l’histoire, l’anthropologie et la sociologie.
Il n’en reste pas moins que les historiens, souvent mal à l’aise face à un langage dont ils ne maîtrisent pas toujours les codes, se montrent rétifs à intégrer pleinement la musique à leur réflexion et peinent à dégager les productions essentielles d’une discipline beaucoup moins structurée que la leur et dont les travaux ne sont pas recensés avec la même constance ni la même exigence. Parallèlement, les musicologues se sont longtemps limités à piocher dans la production historique les éléments qui agrémentent ou confortent leur propos, sans faire référence aux débats historiographiques sous-jacents, ni s’inscrire pleinement dans ces débats au nom de la pertinence de leur objet.
Pourtant, plusieurs programmes interdisciplinaires consacrés au domaine religieux ont récemment mis en évidence des préoccupations communes et ont bénéficié d’une collaboration étroite entre ces deux disciplines (programmes ANR MUSÉFREM et FABRICA). Il en est de même des recherches menées collectivement ou individuellement dans le domaine des émotions, du paysage sonore et de l’histoire urbaine, qui accordent souvent une place importante aux manifestations sonores dans l’espace sacré. Ce colloque souhaite mettre à profit la dynamique insufflée par ces recherches et offrir un moment de rencontre afin de mieux cerner les objets communs et de confronter les méthodes.
Programme musical
Avec le soutien du CPER INSECT.
En amont du colloque, les étudiants du Jeune Orchestre de l’Abbaye ont travaillé, sous la direction du violoncelliste et chef d’orchestre Christophe Coin, des œuvres religieuses du début du XIXe siècle, qui seront données en concert le 22 mai.
Le programme comprendra plusieurs recréations, dont un Tantum ergo de Bonifazio Asioli (1769-1832) pour un dispositif très original de basse soliste, chœur à trois voix et orchestre ; un Pie Jesu de Pierre Desvignes (1764-1827) pour chœur et orchestre et un Super flumina Babylonis de Bernard Jumentier (1749-1829) pour solistes, chœur et orchestre. Le JOA donnera également le troisième mouvement d’une symphonie de Bernard Jumentier et la symphonie 60 “Il Distratto” de Haydn, selon une instrumentation et un dispositif en usage en France au tournant des XVIIIe et
XIXe siècles.
Comité scientifique
– Rémy Campos (Haute École de Musique, Genève)
– Philippe Canguilhem (Université de Tours)
– Christelle Cazaux-Kowalski (Université de Poitiers)
– Christelle Chaillou-Amadieu (CESCM, Université de Poitiers)
– Bernard Dompnier (Université Clermont Auvergne)
– Thierry Favier (Université de Poitiers)
– Claire Maître (IRHT-CNRS)
– Vincent Petit (Besançon)
– Catherine Vincent (Université Paris Nanterre)
Informations complémentaires
Contact
Thierry Favier
thierry.favier@univ-poitiers.fr