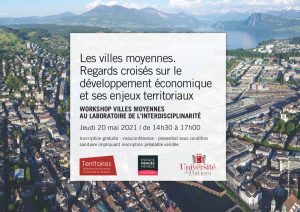 • Jeudi 20 mai 2021 – 14h30 / 17h
• Jeudi 20 mai 2021 – 14h30 / 17h
• En visioconférence, sur inscription préalable
Présentation
Un Français sur cinq vit actuellement dans une ville moyenne (si on retient l’acception selon laquelle elles correspondent aux villes rassemblant entre 50 000 et 200 000 habitants) ; en dépit de leur importance, les villes moyennes ont longtemps été délaissées. La métropolisation semblait les avoir exclues de la dynamique des systèmes productifs exigeant innovation et des services de haute technologie et elles ont longtemps souffert d’une relative indifférence de la part des pouvoirs publics. Il existe, à l’évidence, un renouveau de la question des villes moyennes ces dernières années. D’une part, celles-ci deviennent le terrain d’expérimentation de nouvelles politiques publiques (« petites villes de demain », « action coeur de ville », « revitalisation des centres bourgs »). D’autre part, au-delà d’appréciations condescendantes du type «il fait bon y vivre », elles attirent à nouveau : une enquête IFROP réalisée à l’issue du premier confinement révélait leur attractivité croissante : 84 % des Français considéraient qu’habiter dans une ville de taille moyenne est préférable.
Plusieurs éléments rappelés ici suscitent des interrogations, à commencer par la manière dont les pouvoirs publics se représentent les villes moyennes et s’en saisissent. Les dispositifs publics proposés pour les villes moyennes sont-ils adaptés à leur organisation territoriale ? Dans ces politiques, ne considère-t-on pas la ville moyenne comme une « mini » métropole ? Peut-on appliquer les mêmes schémas à ces territoires qu’aux métropoles ? Ces premières interrogations posent la question de la spécificité des villes moyennes et l’éternelle question de leur définition. Il est bien évident que cet ensemble de villes présente de fortes différences et relève d’un regroupement très hétérogène : on y trouve des villes isolées, ou au contraire incluses dans des aires urbaines, des villes aux fonctions limitées et d’autres, petites ou moyennes, qui constituent de véritables centres de services au sein de leur environnement… A cet égard, en observant et comparant leur évolution à travers le temps, on peut mettre utilement en rapport la profondeur des changements sociaux avec les changements spatiaux qui les affectent, et mesurer ainsi, par-delà les convergences, la diversité des situations. De même, en se penchant sur leurs systèmes productifs, la question des mobilités ou les fonctions d’usage des différents espaces qui les composent, on doit pouvoir distinguer ce que sont véritablement les atouts des villes moyennes.
Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agira ici de faire des villes moyennes un objet d’études à saisir par ses multiples réalités. L’objectif ainsi fixé est de faire émerger des problématiques et de proposer de nouvelles approches à travers le regard croisé de différents spécialistes des sciences humaines et sociales.
Intervenants
• Xavier Hurteau, Directeur général Adjoint de la Communauté Urbaine de Grand Angoulême
• Magali Talandier, Professeure des Universités en Urbanisme et Aménagement du territoire au Laboratoire PACTE (Université de Grenoble)
• Sarah Roux, Doctorante en Histoire au Laboratoire Criham (Université de Limoges)
• Elodie Texier, Doctorante en Géographie au Laboratoire Ruralités
Informations complémentaires
Inscription
https://recherche.univ-poitiers.fr/territoires/workshop01/
Contact et inscription
Marie Ferru et François Dubasque
marie.ferru@univ-poitiers.fr, francois.dubasque@univ-poitiers.fr
