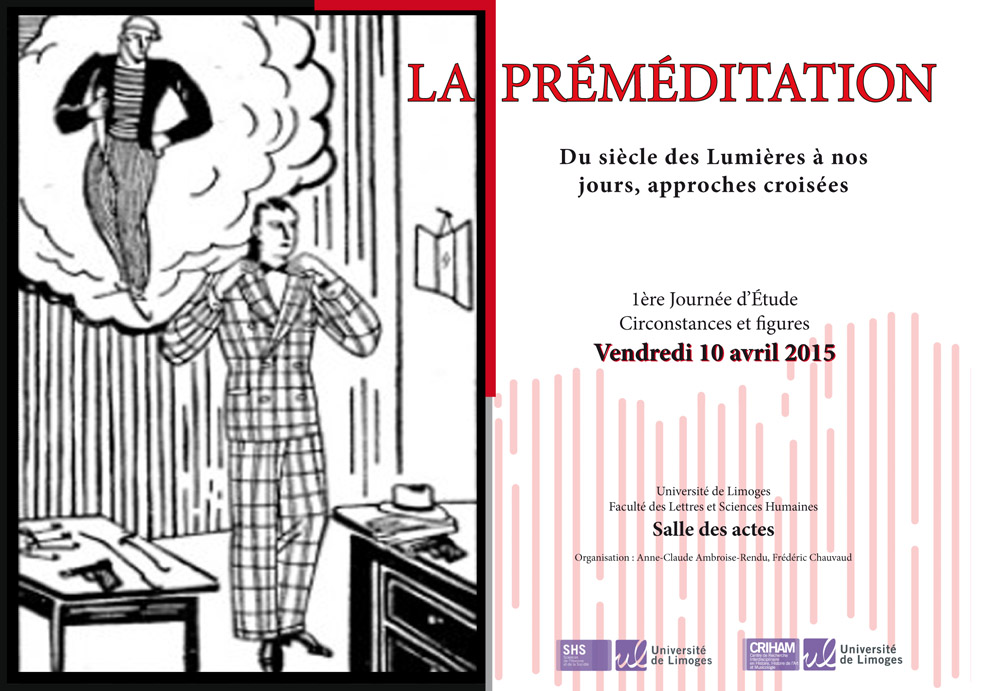• Limoges, faculté des Lettres et Sciences Humaines, salle des actes
39e rue Camille-Guérin
Présentation
La préméditation. Du siècle des Lumières à nos jours, approches croisées
Programme
Première journée : Circonstances et figures
• 9h15 – Introduction. Anne-Claude Ambroise-Rendu (Université de Limoges), Frédéric Chauvaud (Université de Poitiers)
• 9h45 – Pascal Texier (Université de Limoges)
Du conformisme à l’intention : « La préméditation chez les pénalistes des XVIIe et XVIIIe siècles. Contrôle du conformisme ou de l’intention ?
• 10h30 – Discussion et pause
• 11h – Camille Dagot (Université de Strasbourg)
Raconter les circonstances du vol. La place de la préméditation dans les procès pour vol dans les Vosges (XVIe-XVIIe siècles)
• 11h45 – Olivier Caporossi (Université de Pau)
La préméditation dans les crimes de monnaie en Espagne au XVIIIe siècle
14h – Jean-Claude Farcy (CNRS)
Apprécier la préméditation. Quelques remarques sur la pratique judiciaire (France XIXe siècle)
14h45 – Karine Salomé (Université de Paris I)
La préméditation occultée dans les affaires de vitriol à la fin du XIXe siècle
15h30 – Discussion et pause
16h00 – Anne-Emmanuelle Demartini (Université de Paris Diderot)
Préméditation et poison à l’époque contemporaine
16h45 – François Brizay (Université de Poitiers)
Des meurtres et des violences préméditées : l’exemple de la mafia sicilienne
Comité scientifique
– Jean-Claude Farcy (CNRS),
– Benoît Garnot,
– Dominique Kalifa,
– Jean-Paul Jean,
– Jean-Clément Martin,
– David Niget,
– Michel Porret,
– Myriam Tsikounas.
Argumentaire
Informations complémentaires
Contact
Frédéric Chauvaud
frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr