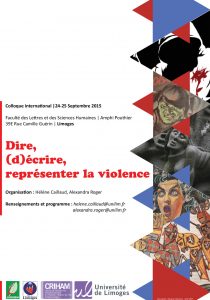• Limoges, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, amphi Pouthier
39E, rue Camille Guérin
• Entrée libre
Présentation
À regarder autour de nous, dans les journaux, les jeux vidéo, au cinéma, la violence semble aujourd’hui omniprésente, et faire partie de notre quotidien. Constat que fait d’ailleurs Robert Muchembled dans l’introduction de son Histoire de la violence. De la fin du Moyen Âge à nos jours. La notion de « violence » reste cependant difficile à définir car elle fait appel à un système de représentations, de normes propres à chaque société. Ainsi un comportement n’est violent que s’il apparaît comme transgressif, comme illégitime aux yeux de la société dans laquelle il est perpétré. Aussi, entendrons-nous la violence comme transgression de la norme, cette dernière pouvant être définie comme l’ensemble des règles, lois, coutumes…fixant les comportements attendus au sein d’une société donnée. De nos jours, souvent dénoncée par les politiques, prônée par des groupes extrémistes, la violence est parfois un moyen de contrôler et d’haranguer les foules. De même, la mise en discours ou en image de la violence peut être à l’origine d’une quête de légitimité de la part d’un groupe social, d’une institution. Par le biais de représentations, d’intensifications, de dramatisations, tout un chacun, à travers son discours ou son œuvre, participe à légitimer ou, au contraire, à dénoncer certaines formes de violence. Il s’agira alors d’identifier et d’analyser les stratégies discursives et de les replacer dans leur contexte de production et de réception. En quoi cette « mise en scène » de la violence participe-t-elle de la construction ou, au contraire, de la contestation d’une définition de la violence ? Dans quelle mesure l’étude de la violence et de ses discours représente-t-elle une fenêtre ouverte sur les sociétés qui les façonnent ?
Trois grands axes de réflexion ont été retenus :
• La violence : discours et société
En quoi les discours et les représentations de la violence sont-ils révélateurs de la société dans laquelle ils voient le jour ?
• Violence et média
Le média est entendu dans un sens très large, c’est-à-dire tout procédé servant à la diffusion, à la communication. Cet axe entend s’interroger non seulement sur les aspects concrets, matériels, de la représentation de la violence, mais aussi sur la réception du message véhiculé.
• Le discours/la représentation de la violence et les pouvoirs : entre légitimation et dénonciation
Comment la violence est-elle « instrumentalisée » par différents acteurs à des fins de légitimation ou, au contraire, de dénonciation de cette violence ? En quoi cet usage du concept de violence participe-t-il à sa redéfinition ?
Comité scientifique
Programme
Jeudi 24 septembre 2015
• 10h – Accueil des participants
Mot d’ouverture d’Anne-Claude Ambroise Rendu (Professeur d’histoire contemporaine, Directrice adjointe du CRIHAM)
1ère Séance
Président de séance : Michel Nassiet (Professeur d’histoire moderne, Angers)
• 10h30 – conférence inaugurale de Michel Nassiet
Session 1 : La violence fondatrice
11h-12h30
• Frédérica Zephir (Professeur de Lettres, Université de Nice Sophia-Antipolis)
Seigneurs, étrangers, marginaux et autres figures de la violence dans l’œuvre de Panaït Istrati
• Cecilia Gosso (Ph.D. Political Sience and International Relation Dipartimento Culture, Politica e Società Università degli Studi, Turin)
Las violencias y el Estado en El Salvador :
desde la violencia politica hacia la violencia multifactorial
• Discussion
2e séance
Président de séance : Frédéric Chauvaud (Professeur d’histoire contemporaine, Poitiers)
Session 2 : Protéger
13h45-15h45
• Jean-François Thibault (Professeur, Département de science politique, Université de Moncton, Canada)
Violence vertueuse et mise en forme, en sens et en scène du principe de responsabilité de protéger
• Gillonne Desquesnes (Maître de Conférences en sociologie, Université de Caen) et Dominique Beynier (Professeur de Sociologie, Université de Caen)
De quelques représentations de la maltraitance envers les enfants chez les professionnels impliqués dans la protection de l’enfance
• Benoît Kastler (Doctorant, Marge, Lyon 3)
La socialisation progressive à la violence cinématographique
• Discussion et pause
Session 3 : Instrumentaliser
16h15-17h30
• Nicolas Vabre (Docteur en histoire contemporaine, Université du Havre)
Le cas Alexandre Burnouf : usages et régulations de la violence par un syndicaliste ouvrier dans le premier tiers du 20e siècle
• Christina Theodosiou (Docteure en histoire contemporaine, Paris 1)
Violence des tranchées dans les discours commémoratifs de la Grande Guerre
• Discussion
Vendredi 25 septembre 2015
3e Séance
Présidente de séance : Nathalie Grande (Professeur de Littérature française du XVIIe siècle, L’AMo, Université de Nantes)
Session 4 : Verbaliser
9h-10h15
• Anne-Sophie Morel (Maître de Conférences, Université de Savoie Mont-Blanc)
Discours de la violence dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand
• Aurore Drécourt (Doctorante en histoire moderne, Université de Liège).
Discours et stratégies dans les déclarations criminelles élaborées devant les notaires liégeois aux XVIIe et XVIIIe siècles
• Discussion et pause
Session 5 : Légitimer
10h30-12h30
• Anthony Saudrais (Doctorant en histoire de l’art, Rennes 2)
Réécrire, chanter et représenter la violence : Philomèle (1705) de Pierre-Charles Roy
• Ludovic Piffaut (Docteur en musicologie, Poitiers).
Meurtres, cruautés et violences sur les scènes lyriques vénitiennes entre 1690 et 1700
• François Wallerich (Doctorant en histoire médiévale, Nanterre
Violences rituelles, eucharistie et société (XIe-XIIIe siècles)
• Discussion
4e Séance
Président de séance : Christophe Regina (Docteur en histoire moderne, Université Jean Jaurès, Framespa)
Session 6 : Édifier
14h-15h20
• Anaïs Rolez (Docteure, Rennes)
La violence dans la sculpture tinguelienne
• Patricia Ehl (Docteure en langue et littérature latine, Université de Lorraine)
De la représentation de la violence sur la scène jésuite : la fin de Cyrus dans Cyrus Punitus de Pierre Mousson (1621)
• Discussion et pause
Session 7 : Réagir
15h35-17h
• Kevin Saule (Docteur en histoire moderne)
Réagir à la violence de son curé. Les paroissiens face aux curés violents dans le diocèse de Beauvais au XVIIe siècle
• Cécile Robelin (Docteure ès lettres).
Rhétorique romanesque et violence insurrectionnelle
• Discussion
• 17h – Conclusions Anne-Claude Ambroise-Rendu (Professeur d’histoire contemporaine, Directrice adjointe du CRIHAM) et Éric Sparhubert (Maître de Conférences en histoire de l’art, Limoges)