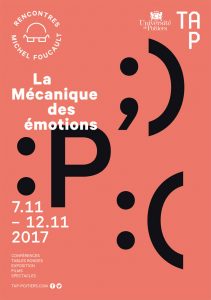• Poitiers, TAP – Théâtre auditorium et autres lieux
6 rue de la Marne
• Entrée libre et gratuite pour les conférences, tables rondes et l’exposition.
Présentation
Mais qu’ont donc en commun les spectacles, la nuit, les faits divers, les meetings politiques, les manifestations sportives, les réalisations humaines généreuses et originales ?
Les émotions collectives. Celles qui soudent les groupes déjà constitués dans la galvanisation mais aussi celles que nous vivons seuls face à notre écran d’ordinateur et qui nous lient de fait avec des milliers d’autres inconnus dans le monde entier. Elles font et défont les puissants, créent des mouvements gigantesques. Revers inévitable, elles sont aussi des armes redoutables de manipulation des masses.
Alors, qu’elles nous guident, nous submergent ou nous révoltent, ces « émotions collectives » méritent que l’on se penche sur leur histoire, qu’on en dissèque le fonctionnement peut-être. Avec le plaisir d’accueillir Georges Vigarello en ouverture, nous vous proposons à nouveau une série de conférences, de tables rondes et de spectacles très riches et très ouverts. Spécialistes, étudiants et curieux, ces rencontres sont pour vous.
Table ronde : Le Dernier Round : la ferveur du public pour les champions du ring
Jeudi 9 novembre 2017 – 14h/15h30 – TAP auditorium
En collaboration avec l’Université Inter-Âges
Table ronde animée par Frédéric Chauvaud avec André Rauch et Mahyar Monshipour
Aujourd’hui la boxe connaît un nouvel engouement. Les Jeux Olympiques de Rio, en 2016, où Tony Yoka et Estelle Mossely s’imposèrent en finale et furent sacrés champions, l’attestent. Dans la première moitié du 20e siècle, la boxe, source d’émotions collectives, était très populaire. Des personnalités phares, comme Marcel Cerdan, faisaient l’objet d’un véritable culte. Les spectateurs se bousculaient pour obtenir des places. Plus tard, en mars 1971, le « combat du siècle », opposant Joe Frazier et Mohamed Ali, suscita un enthousiasme international. Plus récemment, les combats de Mahyar Monshipour aux championnats du monde (2003 – 2006) ont provoqué une véritable ferveur. Mais il convient de se demander quelles émotions, quels publics, quels médias la boxe met en branle.
– Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Poitiers, spécialiste de la justice et du corps malmené. Il a notamment publié, en collaboration, Le Sarcasme du mal. Histoire de la cruauté de la Renaissance à nos jours et Le Corps en lambeaux. Histoire des violences sexuelles et sexuées faites aux femmes (PUR, 2016).
– Mahyar Monshipour, boxeur amateur devient professionnel en 1996. Selon un journaliste, il fait partie de la catégorie des « cogneurs techniques ». Il gagne par KO dans 21 matchs professionnels. En janvier 2002, il devient champion de France des super-coqs. L’année suivante, il est champion du monde des super-coqs, titre qu’il conserve jusqu’en 2006.
– André Rauch professeur émérite des universités est chercheur dans l’équipe ISOR (Paris 1 et Paris 4). Il a publié de nombreux ouvrages dont Luxure. Entre péché et jouissance (Armand Colin, 2016) et un livre qui a fait date Boxe, violence du XXe siècle (Aubier, 1992) dans lequel il réhabilite ce sport. Le ring étant un théâtre à la fois social et émotionnel.
Réalisation : i-médias / Université de poitiers
Table ronde : Le temps qu’il fait : les émotions politiques
Vendredi 10 novembre 2017 – 14h/15h30 – TAP auditorium
Table ronde animée par François Dubasque avec Guillaume Garnier et Cédric Germain
Attentats, Brexit, campagnes électorales, ces événements viennent nous rappeler à quel point les émotions participent de notre manière d’être ou d’agir. Leur forte imprégnation dans notre quotidien met en lumière l’importance de s’en saisir comme objet d’études et notamment d’historiciser le phénomène pour mieux appréhender l’évolution de nos sociétés. Les émotions s’inscrivent en effet dans des temporalités et des sociologies qui intéressent tout autant l’histoire politique, l’histoire des représentations collectives ou l’histoire sociale. La mise en relation du champ des émotions avec le temps spécifique de la nuit – temps propice à la violence comme au débat – apparaît ainsi comme l’une des pistes fécondes qui donne à voir une autre sensibilité humaine.
– François Dubasque est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Poitiers et membre du Criham (EA 4270). Ses travaux de recherche portent sur le personnel politique français contemporain et sur les pratiques politiques dans leur dimension territoriale. Il a publié Jean Hennessy (1874 – 1944), Argent et réseaux au service d’une nouvelle république (PUR, 2008) et récemment codirigé plusieurs ouvrages dont Terres d’élections. Les Dynamiques de l’ancrage politique (1750 – 2009), avec É. Kocher-Marboeuf (PUR, 2014).
– Guillaume Garnier (Criham) est docteur en histoire moderne et contemporaine des universités de Genève et de Poitiers, ses recherches portent sur les pratiques et les représentations du sommeil aux 17e et 19e siècles (L’Oubli des peines. Une histoire du sommeil (1700 – 1850) – PUR, 2013) et sur la perspicacité des événements nocturnes. Il codirige actuellement un ouvrage collectif sur L’Histoire des nuits blanches depuis l’Antiquité.
– Cédric Germain est doctorant (FoRell) et professeur de lettres classiques au Lycée Jean Macé à Niort. Son sujet de thèse porte sur les comédies d’Aristophane, il s’intéresse plus particulièrement aux révoltes nocturnes et aux banquets festifs dans Lysistrata et L’Assemblée des femmes.
Réalisation : i-médias / Université de Poitiers